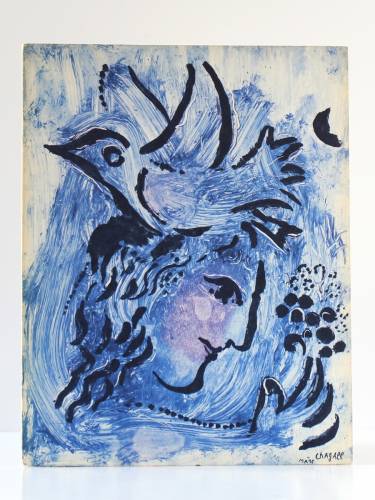 Ce rêve ne figure qu’en note de l’interprétation du rêve1. Il a été rapporté par le docteur Hermine von Hug-Hellmuth et il est cité par Freud pour décrire ce qu’est la fonction de la censure dans la déformation du rêve. Il n’a pas été interprété mais il est malgré tout assez transparent.
Ce rêve ne figure qu’en note de l’interprétation du rêve1. Il a été rapporté par le docteur Hermine von Hug-Hellmuth et il est cité par Freud pour décrire ce qu’est la fonction de la censure dans la déformation du rêve. Il n’a pas été interprété mais il est malgré tout assez transparent.
Celle qui rêve est une femme de cinquante ans, veuve depuis douze ans d’un colonel de l’armée et dont l’un de ses fils est lui aussi dans l’armée.
Freud écrit « Pour effacer les passages qui lui paraissent choquants la défiguration onirique travaille dans cet exemple avec les mêmes moyens que la censure épistolaire. Celle-ci rend ce genre de passages illisibles en les recouvrant d’un large trait d’encre, la censure onirique les remplace par un marmonnement incompréhensible »
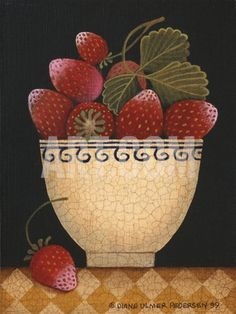 Parmi tous les rêves d’enfants que Freud décrit dans ce chapitre III intitulé « le rêve est une satisfaction de désir », se trouvent deux rêves qui méritent d’être rapprochés l’un de l’autre, surtout si on les inscrit sur les deux chaînes, signifiante et signifiée, du graphe du désir.
Parmi tous les rêves d’enfants que Freud décrit dans ce chapitre III intitulé « le rêve est une satisfaction de désir », se trouvent deux rêves qui méritent d’être rapprochés l’un de l’autre, surtout si on les inscrit sur les deux chaînes, signifiante et signifiée, du graphe du désir.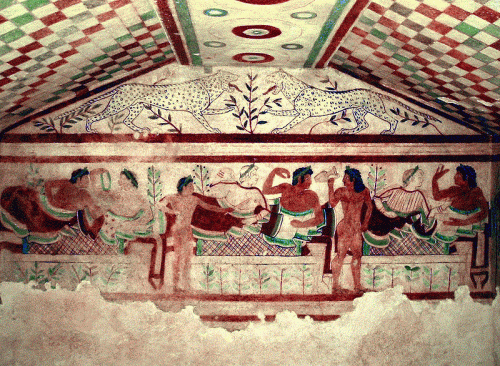 A l’orée de ce nouveau chapitre, chapitre III ayant pour titre « Le rêve est une satisfaction de désir » Freud devient lyrique. Il admire le paysage qui se présente devant lui, prend le temps de choisir les chemins qu’il empruntera, se réjouit surtout de l’exploit accompli. On le sent heureux et il y a de quoi : « Quand au sortir d’un nouveau chemin creux on débouche soudain sur une hauteur où les chemins se divisent et où s’offrent au regard dans des directions différentes les perspectives les plus riches, on a bien le droit de se poser un instant et de se demander de quel côté on va d’abord tourner ses pas. Quelque chose de semblable nous arrive à présent, maintenant que nous avons passé le cap de cette première interprétation d’un rêve. Nous sommes dans la grande clarté d’une révélation soudaine». Arrivé au sommet, Freud admire le panorama qui se présente à lui.
A l’orée de ce nouveau chapitre, chapitre III ayant pour titre « Le rêve est une satisfaction de désir » Freud devient lyrique. Il admire le paysage qui se présente devant lui, prend le temps de choisir les chemins qu’il empruntera, se réjouit surtout de l’exploit accompli. On le sent heureux et il y a de quoi : « Quand au sortir d’un nouveau chemin creux on débouche soudain sur une hauteur où les chemins se divisent et où s’offrent au regard dans des directions différentes les perspectives les plus riches, on a bien le droit de se poser un instant et de se demander de quel côté on va d’abord tourner ses pas. Quelque chose de semblable nous arrive à présent, maintenant que nous avons passé le cap de cette première interprétation d’un rêve. Nous sommes dans la grande clarté d’une révélation soudaine». Arrivé au sommet, Freud admire le panorama qui se présente à lui. Dans la séance précédente, celle du 9 février 1956, Lacan a commencé à lire ce rêve de l’injection faite à Irma avec l’aide du schéma L. Il inscrit ainsi sur l’axe imaginaire du schéma (du petit autre au moi), toute la première partie de ce rêve où Freud s’identifie avec toute la série des femmes puis des hommes qui ont été invités à discuter avec lui de l’état de santé d’Irma. sur l’axe symbolique (du grand A au S), Il inscrit ce qu’il appelle « sa conversation inconsciente avec Fliess, ce qui correspond donc à son auto-analyse. Nous avons donc là une première vue d’ensemble de la structure de ce rêve.
Dans la séance précédente, celle du 9 février 1956, Lacan a commencé à lire ce rêve de l’injection faite à Irma avec l’aide du schéma L. Il inscrit ainsi sur l’axe imaginaire du schéma (du petit autre au moi), toute la première partie de ce rêve où Freud s’identifie avec toute la série des femmes puis des hommes qui ont été invités à discuter avec lui de l’état de santé d’Irma. sur l’axe symbolique (du grand A au S), Il inscrit ce qu’il appelle « sa conversation inconsciente avec Fliess, ce qui correspond donc à son auto-analyse. Nous avons donc là une première vue d’ensemble de la structure de ce rêve.
 Freud a fait précédé le rêve de l’injection faite à Irma, d’une sorte de préambule qu »il a appelé « Informations préalables ». Elles étaient en effet destinées à indiquer en quelles circonstances Freud avait fait ce rêve. Son ami Otto lui avait donné la veille des nouvelles d’Irma, l’une de ses analysantes. Elle n’allait pas très bien, selon lui, et se plaignait toujours de ses malaises. Ce qui a incommodé Freud au plus au point. Ce rêve de l’injection faite à Irma, est, selon son propre aveu, un rêve de disculpation par rapport à ce qui est arrivé à Irma, mais aussi et peut-être avant tout un rêve de vengeance, le problème étant de savoir quel en était la cible réelle. Était-ce bien ce pauvre Otto, le porteur de cette mauvaise nouvelle, ou bien le Dr M. ? C’est en tout cas eux qui en font les frais dans le contenu manifeste de ce rêve. Mais on ne sait quel en sera la vraie victime dans le contenu latent.
Freud a fait précédé le rêve de l’injection faite à Irma, d’une sorte de préambule qu »il a appelé « Informations préalables ». Elles étaient en effet destinées à indiquer en quelles circonstances Freud avait fait ce rêve. Son ami Otto lui avait donné la veille des nouvelles d’Irma, l’une de ses analysantes. Elle n’allait pas très bien, selon lui, et se plaignait toujours de ses malaises. Ce qui a incommodé Freud au plus au point. Ce rêve de l’injection faite à Irma, est, selon son propre aveu, un rêve de disculpation par rapport à ce qui est arrivé à Irma, mais aussi et peut-être avant tout un rêve de vengeance, le problème étant de savoir quel en était la cible réelle. Était-ce bien ce pauvre Otto, le porteur de cette mauvaise nouvelle, ou bien le Dr M. ? C’est en tout cas eux qui en font les frais dans le contenu manifeste de ce rêve. Mais on ne sait quel en sera la vraie victime dans le contenu latent. La deuxième partie de cet ouvrage, « L’interprétation du rêve », a pour titre « la méthode d’interprétation du rêve ; Analyse d’un modèle de rêve ». Nous arrivons donc à la lecture du fameux rêve de l’injection faite à Irma, longuement depuis commenté par les analystes et notamment par Lacan dans le séminaire « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse ». Mais auparavant, Freud, en quelques pages pose, avec brio et rigueur, ce qu’il en est de la règle analytique, celle de l’association libre. C’est dans le cadre de cette thérapeutique des symptômes qu’il replace en effet la théorie du rêve et les possibilités de son interprétation.
La deuxième partie de cet ouvrage, « L’interprétation du rêve », a pour titre « la méthode d’interprétation du rêve ; Analyse d’un modèle de rêve ». Nous arrivons donc à la lecture du fameux rêve de l’injection faite à Irma, longuement depuis commenté par les analystes et notamment par Lacan dans le séminaire « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse ». Mais auparavant, Freud, en quelques pages pose, avec brio et rigueur, ce qu’il en est de la règle analytique, celle de l’association libre. C’est dans le cadre de cette thérapeutique des symptômes qu’il replace en effet la théorie du rêve et les possibilités de son interprétation.
