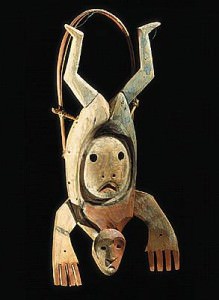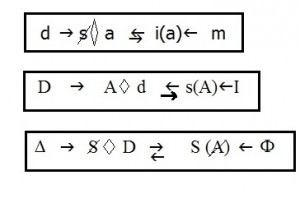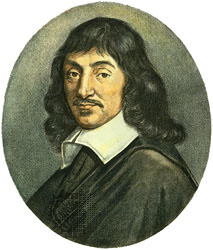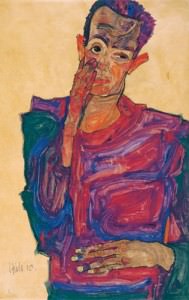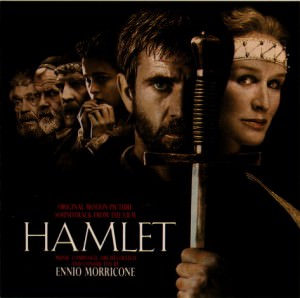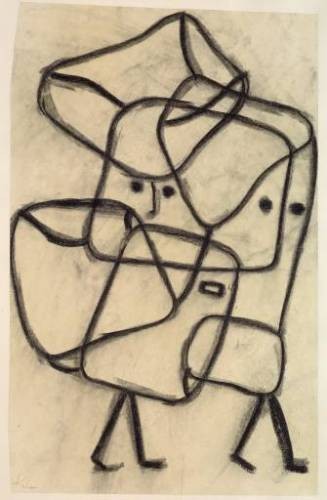 En plus des deux versions existantes de Joyce le symptôme, il existe un troisième texte qui a pour titre : « De James Joyce comme symptôme ». C’est le texte d’une conférence qui a eu lieu à Nice en janvier 1976.
En plus des deux versions existantes de Joyce le symptôme, il existe un troisième texte qui a pour titre : « De James Joyce comme symptôme ». C’est le texte d’une conférence qui a eu lieu à Nice en janvier 1976.
Lacan dans ce texte commence par rappeler ce qui est son mode de lecture de Freud :
« C’est dans lalangue, avec toutes les équivoques qui résultent de tout ce que lalangue supporte de rimes et d’allitérations, que s’enracine toute une série de phénomènes que Freud a catalogués et qui vont du rêve, du rêve dont c’est le sens qui doit être interprété, du rêve à toutes sortes d’autres énoncés qui, en général, se présentent comme équivoques, à savoir ce qu’on appelle les ratés de la vie quotidienne, les lapsus, c’est toujours d’une façon linguistique que ces phénomènes s’interprètent, et ceci montre… montre aux yeux de Freud que un certain noyau, un certain noyau d’impressions langagières est au fond de tout ce qui se pratique humainement, qu’il n’y a pas d’exemple que dans ces trois phénomènes – le rêve, le lapsus (autrement dit la pathologie de la vie quotidienne, ce qu’on rate), et la troisième catégorie, l’équivoque du mot d’esprit –, il n’y a pas d’exemple que ceci comme tel ne puisse être interprété en fonction […] d’un premier jeu qui est… dont ce n’est pas pour rien qu’on peut dire que la langue maternelle, à savoir le soin que la mère a pris d’apprendre à son enfant à parler, ne joue un rôle ; un rôle décisif un rôle toujours définitif ; et que, ce dont il s’agit, c’est de s’apercevoir que ces trois fonctions que je viens d’énumérer, rêve, pathologie de la vie quotidienne : c’est-à-dire simplement de ce qui se fait, de ce qui est en usage, la meilleure façon de réussir, c’est, comme l’indique Freud, c’est de rater. Il n’y a pas de lapsus, qu’il soit de la langue ou de la plume, il n’y a pas d’acte manqué qui n’ait en lui sa récompense. C’est la seule façon de réussir, c’est de rater quelque chose. Ceci grâce à l’existence de l’inconscient.