
Le rêve qui suit fait encore partie de la série des rêves qui paraissent démentir l’affirmation de Freud que le rêve est une réalisation de désir. Ils sont tous cités dans le chapitre « La déformation du rêve » ou « La défiguration onirique ».
Voici le texte de ce rêve qui n’est pas celui d’un analysant mais d’une connaissance de Freud, un juriste : « Je rêve, rapporte mon informateur que j’arrive devant chez moi, une dame à mon bras. Là attend une voiture fermée, un monsieur s’avance vers moi, excipe de sa qualité d’agent de police et m’enjoint de le suivre. Je le prie seulement de me laisser le temps de régler mes affaires ».1


 j’ai commencé à travailler ce nouveau rêve. Il a un intérêt supplémentaire, outre son interprétation, c’est celui de montrer ce qu’était la technique analytique de Freud, en ce temps de l’interprétation des rêves. Il semble bien qu’il faisait, en fonction du matériau analytique livré par l’analysant, des hypothèses sur les événements survenus dans l’enfance du sujet qui avaient dû provoquer la névrose et surtout qu’il ne les gardait pas pour lui et lui en faisait part. Je pense que cette démarche devait correspondre à ce qu’il décrivait dans son article « Constructions en analyse ».
j’ai commencé à travailler ce nouveau rêve. Il a un intérêt supplémentaire, outre son interprétation, c’est celui de montrer ce qu’était la technique analytique de Freud, en ce temps de l’interprétation des rêves. Il semble bien qu’il faisait, en fonction du matériau analytique livré par l’analysant, des hypothèses sur les événements survenus dans l’enfance du sujet qui avaient dû provoquer la névrose et surtout qu’il ne les gardait pas pour lui et lui en faisait part. Je pense que cette démarche devait correspondre à ce qu’il décrivait dans son article « Constructions en analyse ».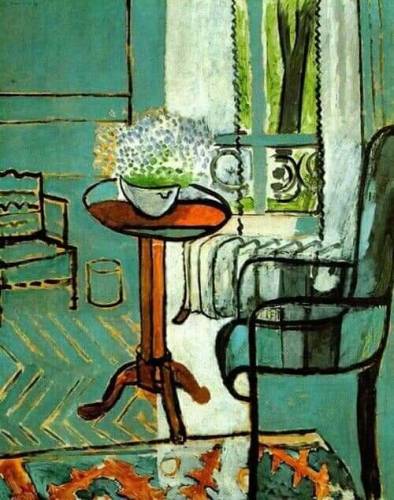
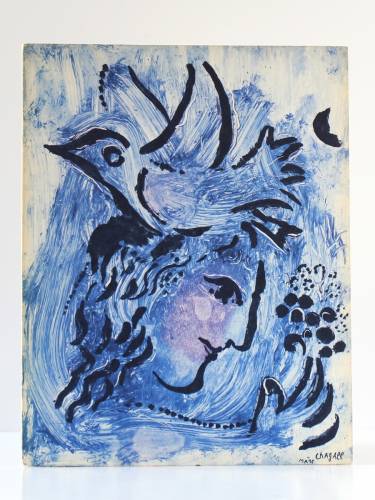 Ce rêve ne figure qu’en note de l’interprétation du rêve1. Il a été rapporté par le docteur Hermine von Hug-Hellmuth et il est cité par Freud pour décrire ce qu’est la fonction de la censure dans la déformation du rêve. Il n’a pas été interprété mais il est malgré tout assez transparent.
Ce rêve ne figure qu’en note de l’interprétation du rêve1. Il a été rapporté par le docteur Hermine von Hug-Hellmuth et il est cité par Freud pour décrire ce qu’est la fonction de la censure dans la déformation du rêve. Il n’a pas été interprété mais il est malgré tout assez transparent.
 Dans ce chapitre III intitulé « le rêve est une réalisation de désir », Freud décrit quelques rêves qu’il qualifie de « simples ». Et bien sûr on peut se poser la question de ce qu’il entend par là. De la série d’exemples qu’il donne, il me semble qu’on peut en déduire qu’ils sont simples à déchiffrer et donc à interpréter. Ils ne font pas mystère du désir qui s’y exprime. Celui-ci n’est pas masqué, déguisé, comme il le précisera dans le chapitre suivant sous le titre la « défiguration du rêve ».
Dans ce chapitre III intitulé « le rêve est une réalisation de désir », Freud décrit quelques rêves qu’il qualifie de « simples ». Et bien sûr on peut se poser la question de ce qu’il entend par là. De la série d’exemples qu’il donne, il me semble qu’on peut en déduire qu’ils sont simples à déchiffrer et donc à interpréter. Ils ne font pas mystère du désir qui s’y exprime. Celui-ci n’est pas masqué, déguisé, comme il le précisera dans le chapitre suivant sous le titre la « défiguration du rêve ».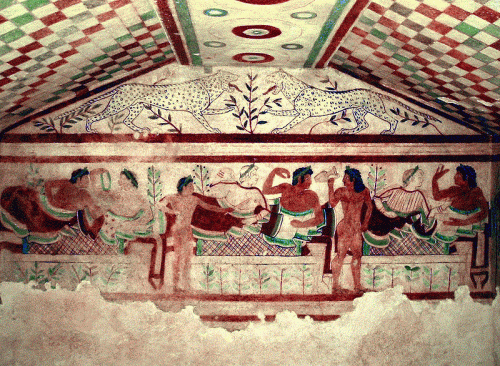 A l’orée de ce nouveau chapitre, chapitre III ayant pour titre « Le rêve est une satisfaction de désir » Freud devient lyrique. Il admire le paysage qui se présente devant lui, prend le temps de choisir les chemins qu’il empruntera, se réjouit surtout de l’exploit accompli. On le sent heureux et il y a de quoi : « Quand au sortir d’un nouveau chemin creux on débouche soudain sur une hauteur où les chemins se divisent et où s’offrent au regard dans des directions différentes les perspectives les plus riches, on a bien le droit de se poser un instant et de se demander de quel côté on va d’abord tourner ses pas. Quelque chose de semblable nous arrive à présent, maintenant que nous avons passé le cap de cette première interprétation d’un rêve. Nous sommes dans la grande clarté d’une révélation soudaine». Arrivé au sommet, Freud admire le panorama qui se présente à lui.
A l’orée de ce nouveau chapitre, chapitre III ayant pour titre « Le rêve est une satisfaction de désir » Freud devient lyrique. Il admire le paysage qui se présente devant lui, prend le temps de choisir les chemins qu’il empruntera, se réjouit surtout de l’exploit accompli. On le sent heureux et il y a de quoi : « Quand au sortir d’un nouveau chemin creux on débouche soudain sur une hauteur où les chemins se divisent et où s’offrent au regard dans des directions différentes les perspectives les plus riches, on a bien le droit de se poser un instant et de se demander de quel côté on va d’abord tourner ses pas. Quelque chose de semblable nous arrive à présent, maintenant que nous avons passé le cap de cette première interprétation d’un rêve. Nous sommes dans la grande clarté d’une révélation soudaine». Arrivé au sommet, Freud admire le panorama qui se présente à lui. Dans le séminaire « Le Moi dans la théorie de Freud et de la technique analytique », Lacan consacre une dernière séance, celle du 16 mars 1955, au rêve de l’injection faite à Irma. Beaucoup de fils peuvent être suivis et notamment celui de la question de la régression, mais j’ai choisi de mettre l’accent sur un point qui va continuer à nous servir de façon efficace dans notre lecture de tous les rêves de l’Interprétation des rêves, la façon dont Lacan repère dans ce rêve les trois registres du Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique et surtout comment ils sont en quelque sorte noués l’un aux deux autres.
Dans le séminaire « Le Moi dans la théorie de Freud et de la technique analytique », Lacan consacre une dernière séance, celle du 16 mars 1955, au rêve de l’injection faite à Irma. Beaucoup de fils peuvent être suivis et notamment celui de la question de la régression, mais j’ai choisi de mettre l’accent sur un point qui va continuer à nous servir de façon efficace dans notre lecture de tous les rêves de l’Interprétation des rêves, la façon dont Lacan repère dans ce rêve les trois registres du Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique et surtout comment ils sont en quelque sorte noués l’un aux deux autres.