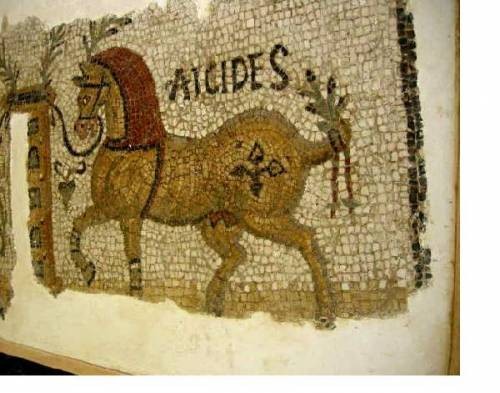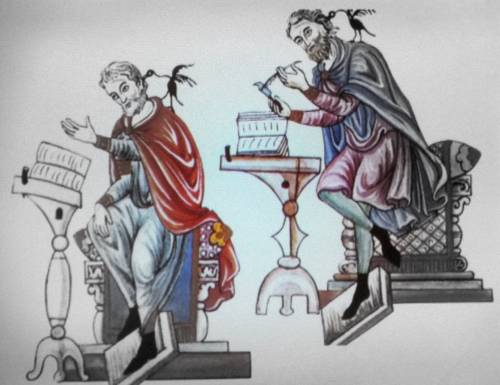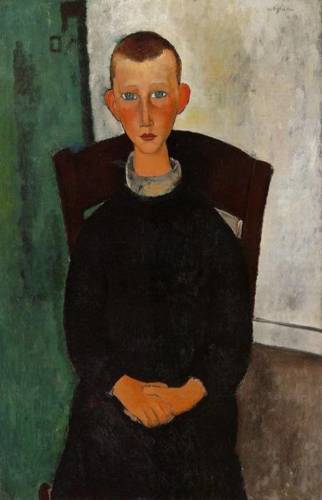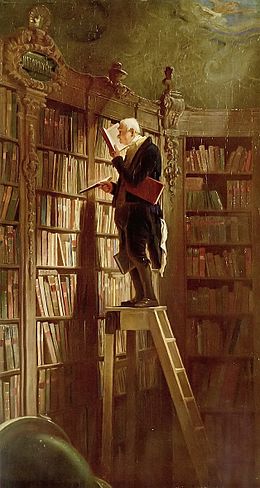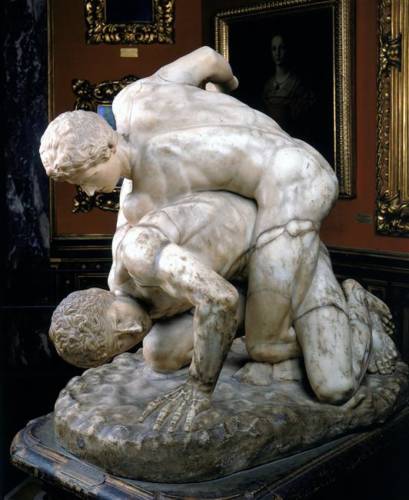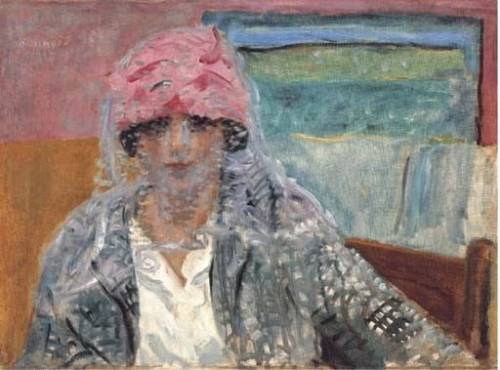En tant qu’une des anciennes analysantes de Lacan je me suis toujours intéressée à ce qu’il disait des femmes et notamment des femmes analystes. Certes, en première lecture, ces apartés sur elles peuvent paraître élogieux, voire très élogieux mais ils méritent une seconde lecture qui leur donne un autre éclairage, en tout cas plus nuancé.
.Au tout début de son enseignement, au cours d’une journée consacrée à l’enfance aliénée qui avait été organisée par Maud Manonni il avait affirmé ceci : « Que veut la femme ? est, on le sait, l’ignorance où reste Freud jusqu’au terme, dans la chose qu’il a mise au monde. Ce que femme veut, aussi bien d’être encore au centre aveugle du discours analytique, emporte dans sa conséquence que la femme soit psychanalyste-née (comme on s’en aperçoit à ce que régentent l’analyse les moins analysées des femmes). «